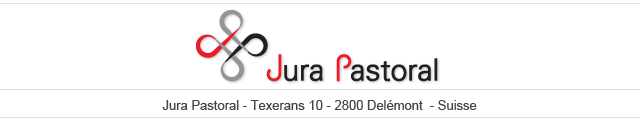Rapport de l’Eglise catholique de Suisse sur les questions concernant les lineamenta au Synode des Evêques 2015 à Rome

Le processus synodal de l’Eglise catholique rencontre un grand écho en Suisse. 25'000 personnes ont participé à une enquête dans le cadre de la préparation du synode extraordinaire des évêques. La préparation du synode des Evêques 2015 est également très suivie. La Conférence des évêques suisses a chargé, à la fin décembre, le secrétariat de sa Commission pastorale à l’Institut suisse de sociologie pastorale de procéder à des sondages sur les thèmes du Synode des Evêques et de préparer un projet de rapport en réponse aux lineamenta.
Pour consulter ou élécharger l'intégralité de ce document de 20 pages, cliquez ICI
A la fin janvier 2015, la Conférence des évêques suisses a appelé les fidèles à mener des discussions synodales. Celles-ci ont été proposées, jusqu’à fin mars, en maints lieux et à maints groupes de l’Eglise catholique en Suisse. Du matériel avait été préparé pour lancer ces discussions sur des questions centrales du Synode et sur les déclarations correspondantes des lineamenta et pour permettre un positionnement personnel des groupes. Les agents pastoraux et les personnes responsables avaient le choix de la manière dont les discussions étaient organisées et menées. Ils étaient priés d’envoyer au secrétariat de la Commission pastorale les résultats essentiels des discussions afin que le présent rapport puisse en tenir compte.
Près de 570 comptes rendus de résultats sont parvenus jusqu’à la rédaction finale du rapport. A cela s’ajoute une bonne cinquantaine de réactions de personnes individuelles ou de couples. Sur la base des indications fournies sur le nombre de participants aux discussions, quelque 6'000 personnes ont pris part au processus synodal, ce qui, vu la brièveté du délai, est un excellent résultat et montre le grand intérêt des catholiques de Suisse au Synode. Les thèmes du couple, du mariage et de la famille sont d’une extrême importance pour de nombreux fidèles.
Deux autres cercles de personnes ont également été priés de fournir des réponses aux lineamenta : des professionnels de la pastorale catholique du couple, du mariage et de la famille (en bref : pastorale familiale) ainsi que des théologiennes et théologiens des facultés de théologie en Suisse ont donné leurs réactions sur les lineamenta.
Le projet de rapport a été formulé durant la Semaine Sainte et sa rédaction a été finalisée durant la Semaine de Pâques avec les évêques responsables, Pierre Farine (Genève), responsable du dicastère Mariage et famille et président de la Commission pastorale de la CES, et Jean-Marie Lovey (Sion, représentant de la Conférence des évêques suisses au Synode 2015 à Rome), afin d’être à Rome jusqu’au 15 avril 2015.
Un fort consensus de la majorité des réponses
Les réactions de la grande majorité des fidèles, des professionnels et des théologiens ne sont évidemment pas homogènes en tous points. Elles présentent toutefois de très fortes analogies et il s’en dégage des tendances principales. Cela pourrait s’expliquer par la méthode choisie pour la consultation (résultats de discussions de groupe). Ce sont en effet surtout les consensus principaux et les demandes communes à l’enseignement de l’Eglise qui ont été transmis comme résultats de discussions. La partie de loin la plus importante des groupes représente des collaborateurs et collaboratrices de l’Eglise, des agentes et agents pastoraux et des catéchistes et surtout des fidèles engagés dans les paroisses, les communes ecclésiastiques et les associations d’Eglise (p.ex. associations de femmes ou de jeunesse) ainsi que dans d’autres groupements et communautés. Ces groupes composent ensemble la partie de loin la plus grande des participants. Ils sont bien représentatifs de la majorité des catholiques qui contribuent à la vie de l’Eglise en Suisse. Leurs réactions expriment souvent des tendances similaires. Les formulations «les fidèles» ou «la majorité des fidèles» ou autres utilisées dans ce rapport se rapportent donc à la grande majorité des réactions reçues sur les différents thèmes du Synode des Evêques.
Positions et souhaits de la minorité des réponses
Mais il y a également eu une minorité de positions nettement divergentes : ces positions émanent, dans une infime mesure, des groupes paroissiaux et, dans une infime mesure également, des cercles d’agents pastoraux. Elles viennent plutôt de groupements qui se caractérisent avant tout par le souci de préserver la doctrine actuelle de l’Eglise. Ces groupements ne sont aucunement homogènes. Ils vont des cercles traditionalistes (Fraternité Saint-Pie X) à des groupes fortement imprégnés du programme théologique du pape Jean-Paul II (théologie du corps) en passant par des groupes qui s’engagement fortement pour une application fidèle de la doctrine en vigueur aujourd’hui dans l’Eglise (surtout en ce qui concerne Humanae Vitae et l’approche par rapport aux divorcés remariés). Les réactions de ces groupes sont aussi variées que leur orientation spécifique et surtout axées sur certains thèmes (immuabilité de la doctrine et de la loi divine, planification familiale naturelle, théologie du corps, observation plus stricte des clarifications canoniques avant le mariage et exigences plus élevées à la pratique de la préparation au mariage). La majorité des positions émanant de ces groupes montre également clairement qu’ils ne sont pas simplement seulement d’accord avec la doctrine catholique actuelle mais cherchent des manières de lui donner un ancrage théologique plus fort et de la transmettre en pastorale de manière appropriée (avec respect, amour, en témoignant et sans condamnation). Ces groupes se montrent souvent plutôt pessimistes en ce qui concerne la société et les tendances culturelles qui caractérisent notre époque. Ils avouent qu’il leur devient toujours plus difficile de vivre leur foi dans la culture dominante et ils attendent de l’Eglise un renforcement de structures permettant de vivre la foi (et l’idéal ecclésial du mariage et de la famille) malgré de nombreuses résistances extérieures.
La pastorale doit essentiellement tendre à appliquer la doctrine existante. A côté d’une base spirituelle (prière, fréquentation de la messe), il y a aussi des suggestions pour soutenir les couples et les familles par des modèles et des témoignages (accompagnement par des couples expérimentés, création de groupes de familles qui vivent selon la doctrine), suggestions pour une pratique plus stricte dans la préparation au mariage, incitations à une planification familiale naturelle et rappels des lois de la foi, du droit naturel, de l’immuabilité de la doctrine de Jésus-Christ et de l’Eglise.
Il n’a pas été facile, sur la base du matériel reçu (y compris des réactions des professionnels de la pastorale et de la théologie), de répondre aux questions en suivant les lineamenta. La raison principale en est une divergence fondamentale de conception du couple, du mariage et de la famille, resp. de l’approche de ces réalités entre, d’une part, le texte et les questions des lineamenta et, d’autre part, les réactions de la plupart des fidèles.
Le présent rapport essaye par conséquent de présenter le plus précisément possible l‘“autre regard“ de la majorité des catholiques hommes et femmes de Suisse qui ont participé aux discussions synodales et d’aborder les questions en partant de celui-ci.
Question préalable se référant à toutes les sections de la Relatio Synodi
La description de la réalité de la famille présente dans la Relatio Synodi correspond-elle à ce que l’on constate dans l’Eglise et dans la société d’aujourd’hui? Quels aspects absents peuvent être intégrés ?
Une autre approche
Le Synode des Evêques et les fidèles de Suisse ne parlent généralement pas le même langage. Voilà comment pourrait se résumer le message délivré par les nombreuses discussions synodales menées dans l’Eglise catholique de Suisse. On le voit très bien à l’usage de l’image de la Sainte Famille.
La proposition des lineamenta de prendre la Sainte Famille comme modèle pour les familles d’aujourd’hui est discutée sous de nombreux aspects. La discussion dévoile les importantes difficultés qui caractérisent, selon les fidèles, l’approche qu’ont les lineamenta de la réalité du mariage et de la famille.
Alors que les lineamenta partent pour l’enseignement de l’Eglise d’une vision et d’un idéal d’une famille dans une continuité ininterrompue et font de la Sainte Famille le modèle de la famille idéale (une approche « top-down (de haut en bas)» du mariage et de la famille), les fidèles réagissent à partir de leurs expériences familiales vécues, diverses, contradictoires, vivantes, avec des ruptures, des guérisons, des bonheurs et des douleurs. Sur cette base, ils portent un autre regard, «bottom-up (du bas en haut)», sur la Sainte Famille : celle-ci n’apparaît nullement comme la forme idéale de la famille mais elle est vue dans l’ambiguïté que décrit la Bible. Elle est ainsi proche, aux yeux de nombreux fidèles, des réalités variées d’aujourd’hui – sans pouvoir cependant servir de modèle. La Sainte Famille ne répond pas à l’idéal familial de la doctrine de l’Eglise – mais il faut pourtant l’apprécier positivement parce qu’elle témoigne des valeurs de la vie, de la communauté, de la solidarité et du soutien mutuel, toute son ambiguïté et malgré les problèmes et tensions apparents. Les fidèles s’approprient ainsi le motif de la sainte Famille, ils le font cependant d’une manière qui va à l’encontre de la vision des lineamenta et de leur vision de la famille idéale.
Cette autre façon d’aborder l’idéal ecclésial de la famille qui est celle de la très grande majorité des catholiques de Suisse, hommes et femmes, qui ont pris part aux discussions synodales, peut être une clef pour comprendre ce qui est dit ci-dessous à propos des différents thèmes et des questions des lineamenta.
Pour la plupart des fidèles, le point de départ et de référence n’est, en effet, pas l’idéal doctrinal, c-à-d., les normes claires que la doctrine a fixées en matière de mariage, de famille et de sexualité, normes qui reposent, elles aussi, sur des préceptes divins supposés objectifs, mais le champ subjectif de leurs expériences et de leur vision des choses. La plupart des fidèles fondent leurs réactions sur leur propre vécu du couple, de la sexualité, du mariage et de la famille ou sur celui de proches. Ce vécu est étayé, expliqué, évalué par des points de vue spirituels, religieux et moraux qui donnent des indications sur la capacité des fidèles à établir des jugements différenciés en matière éthique et spirituel. On peut découvrir ici les grandes lignes d’une théologie du couple et de la famille « depuis le bas ».
Les assertions des lineamenta sur la famille ont été discutées et critiquées en partant de la vision des fidèles. Il en ressort que les expériences et le vécu des fidèles, d’une part, et ce qu’en dit la doctrine de l’Eglise, d’autre part, se recoupent sur des points. Toutefois les commandements de la doctrine ne sont plus reconnus comme des directives obligatoires et des préceptes normatifs incontestés. Les affirmations de la doctrine sont plutôt évaluées à l’aune des expériences de vie et de foi des gens. Et elles ne réussissent que dans une moindre mesure à s’imposer. La critique émise sur de nombreuses positions des lineamenta vient clairement de là. Cette critique peut à juste titre passer pour fondamentale et elle doit obliger le Synode des Evêques à aborder de manière radicalement différente les thèmes de la sexualité, du mariage et de la famille. On dit dans ce contexte qu’il faut voir la distance entre les fidèles et la doctrine de l’Eglise comme un signe des temps et le point de départ d’une évolution et d’un renouvellement de la tradition.
Langue
De nombreuses réactions critiquent le langage utilisé par les lineamenta pour décrire les réalités familiales. On y voit – malgré des efforts sensibles pour être proche de la réalité – une forte rupture entre l’idéal et les réalités ainsi qu’une forte distance mutuelle entre le point de vue officiel de l’Eglise et l’expérience de la grande majorité des fidèles. La critique porte notamment sur des passages de textes qui sont jugés incompréhensibles, blessants, arrogants et prétentieux. Il est frappant de constater que des citations du Pape François sont souvent expressément relevées positivement. Ces estimations expriment aussi notamment des tensions dans les lineamenta eux-mêmes.
En ce qui concerne la qualité de la communication de la doctrine ecclésiale, de nombreux fidèles souhaitent que la communication souligne plus l’estime et la reconnaissance de toute personne et renonce à toute condamnation et exclusion. De nombreux fidèles déplorent une langue incompréhensible qui ne réussit pas à transmettre de manière crédible le message jubilatoire de l’Eglise.
Théologie
Beaucoup des principales formes d’argumentation théologiques, basées sur le droit naturel, suscitent de l‘incompréhension. Elles sont souvent considérées comme compliquées, pas compréhensibles, idéalistes et sans lien avec la réalité vécue par les fidèles. Les assertions sur la vocation et la mission de la famille se heurtent ainsi à la même incompréhension, parce qu’elles ne correspondent souvent pas à la perception qu’en ont les familles. Les assertions théologiques font l’effet de pierres aux fidèles qui demandent du pain. Il leur manque des signes d’une spiritualité du mariage et de la famille proche de leur expérience et de leur vie. On souhaite également une approche des relations dans la pastorale qui prend pour modèle l’attitude philanthropique de Jésus. La sélection étroite opérée dans les témoignages bibliques pour la théologie du mariage est critiquée.
La formulation « Evangile de la Famille » est jugée incompréhensible. On ne voit pas clairement s’il s’agit de l’Evangile pour la famille ou de la doctrine sur la famille comme Evangile ou du témoignage de vie des familles comme expression de l’Evangile.
Eglise
Les déclarations selon lesquelles l’Eglise se décrit elle-même comme experte en humanité ou comme maîtresse et mère suscitent un net rejet. Pour de nombreux fidèles, l’Eglise, respectivement sa doctrine, est au contraire peu proche des hommes et ils ne perçoivent pas non plus son rôle de mère au vu de son manque, ressenti comme total, de compassion à l’égard de personnes qui ne correspondent pas aux normes de la «mère». Et, surtout, le rôle de fidèles comme «enfants» est rejeté dans ce contexte comme étant infantilisant.
Si l’on considère que ces positions viennent de personnes fortement engagées dans l’Eglise et qui s’y identifient fortement, il ne faut pas voir dans la critique aux déclarations que l’Eglise fait sur elle-même dans les lineamenta comme un rejet de l’Eglise. Il faut plutôt y lire une conception de l’Eglise qui voit celle-ci comme un lieu de communication de la foi basée sur le dialogue mais qui ne l’autorise plus à exercer sur les gens une autorité sans conteste en matière de foi et de vie.
Société
La plupart des fidèles ne partagent pas la vision essentiellement négative que portent les lineamenta sur le monde. Ils estiment cette analyse de la culture trop partiale et imprécise. Considérer les évolutions culturelles et sociétales comme presque exclusivement négatives ne correspond pas à la perception qu’en ont les gens et elle ne correspond pas non plus, d’après eux, à la réminiscence historique qui ne peut pas reconnaître dans le passé seulement des temps meilleurs. Parallèlement, les fidèles connaissent les défis que leur posent la société et la culture et y cherchent des réponses.
Aspects manquants
Les professionnels de la pastorale familiale surtout souhaitent une meilleure prise en compte des sciences humaines et sociales. Elle pourrait aider à dessiner une image réaliste du mariage et des nouvelles exigences qu’il pose au couple.
Le manque presque total d’une perception de la dimension personnelle du mariage et de la famille dans les lineamenta provoque une forte irritation. On déplore aussi amèrement l’absence de l’aspect de la conscience et de l’importance de la décision personnelle prise selon sa conscience.
On exprime aussi l’impression que les lineamenta sont restés encore en deçà de la conception du mariage du Concile Vatican II. Ainsi l’élargissement des buts du mariage, décrété alors, et qui a conforté la conception de la dimension relationnelle du mariage est de nouveau passé au second plan dans les lineamenta.
En dernier lieu, on déplore l’absence d’une réflexion nouvelle et adéquate de l’Eglise sur les questions de la sexualité, réflexion qui permettrait à l’Eglise de retrouver sa place de partenaire de discussion dans la société suisse sur ce domaine de la vie. Une telle réflexion nouvelle et fondamentale sur la sexualité devrait cependant s’abstenir de toute ingérence dans la vie des gens.
Questions sur la Ière partie L‘écoute: le contexte et les défis sur la famille
Le contexte socioculturel (nos 5-8)
1. Quelles sont les initiatives en cours et celles qui sont prévues concernant les défis que les contradictions culturelles posent à la famille (cf nos 6-7) ; celles visant au réveil de la présence de Dieu dans la vie des familles ; celles qui tendent à l’éducation et à l’établissement de relations interpersonnelles solides ; celles qui tendent à favoriser des politiques sociales et économiques utiles à la famille ; celles pour résoudre les difficultés liées à l’attention envers les enfants, les personnes âgées et les membres de la famille qui sont malades ; celles pour affronter le contexte culturel plus spécifique où l’Eglise locale est impliquée ?
2. Quels instruments d’analyse emploie-t-on et quels sont les résultats les plus importants concernant les aspects (positifs ou non) du changement anthropologique et culturel? (cf. n° 5). Dans les résultats perçoit-on la possibilité de trouver des éléments communs dans le pluralisme culturel ?
Les lineamenta indiquent vouloir „écouter“ les contextes familiaux. Mais il est difficile de distinguer qui sont les «interlocuteurs», qui est-ce que l’on écoute. Les lineamenta tracent une image essentiellement négative des contextes familiaux. Les fidèles de Suisse rejettent une telle vision essentiellement négative et simplificatrice qui tend à mettre en opposition les réalités idéalisées de l’Eglise et les évolutions sociales et culturelles. Ils voient parfaitement des enjeux difficiles et complexes pour les familles dans la réalité de la société suisse. Mais ils voient aussi et apprécient les libertés, la marge de manoeuvre et les chances que la culture actuelle offre pour la vie et la réussite des familles. Les fidèles formulent aussi notamment des critiques à l’égard de la doctrine de l’Eglise qui s’est mise dans une vision dualiste du monde aussi par ses propres omissions et sa propre faute.
Il manque donc encore l’écoute des contextes dans le monde – et également l’apprentissage et la pratique d’attitudes de communications qui, seules, rendent possible un dialogue honnête avec les gens, les sociétés et les cultures de notre temps. Il faut lire dans ce contexte la critique très souvent formulée à l’égard de la langue et du style de communication des lineamenta. Le texte est jugé prétentieux, arrogant et condamnatoire dans de nombreux passages.
Les réactions des catholiques suisses, hommes et femmes, montrent une vision plus nuancée que celle des lineamenta sur le mariage et la famille. Les lineamenta calquent leur vision de la famille essentiellement sur le mariage religieux. Ce mariage est vu presque exclusivement comme fondement de la famille. Par conséquent, d’autres dimensions d’un mariage, comme, par exemple, la dimension relationnelle, ne sont guère prises en compte comme étant des valeurs et devoirs en soi. Les fidèles montrent clairement, à ce propos, que mariage et famille doivent être bien distingués afin d’éviter des raccourcis de nature théologique et pastorale. Les réalités familiales sont diverses au sein de l’Eglise catholique en Suisse et dépassent le modèle de la famille basé sur le mariage sacramentel (familles recomposées, monoparentales, familles de divorcés remariés, familles arc-en-ciel, mariages conclus hors de l’Eglise…).
Les fidèles souhaitent fortement que l’Eglise et le Synode reconnaissent cette réalité, sachent donc qu’elle existe et la respectent et ne la décrivent pas simplement comme déficitaire, irrégulière, faible ou blessée. Les réactions des fidèles montrent qu’ils attendent que l’Eglise apprécie différentes formes de famille. Cette estime ne doit pas s’appuyer exclusivement sur le critère du mariage religieux comme fondement d’une famille.
A l’inverse, les fidèles mais aussi les professionnels de la pastorale familiale montrent clairement dans leurs prises de position qu’ils estiment que les lineamenta valorisent trop peu le mariage en lui-même. La valeur de la relation conjugale n’apparaît guère et il en naît l’impression d’une instrumentalisation du mariage à des fins de procréation et d’éducation de descendants. Etant donné que la durée d’un mariage sans divorce atteint facilement en Suisse 40-50 ans et plus, les fidèles sont très conscients du fait que la phase de la famille ne constitue qu’une période très courte de la relation conjugale. On déplore l’absence d’une théologie du mariage adaptée à cette évolution de la société moderne.
Du point de vue théologique, ce constat est également valable pour la famille. La vision réductrice des lineamenta sur la famille empêche jusqu’ici de développer une théologie de la famille à part entière. Une telle théologie de la famille pourrait, d’une part, offrir des chances de découvrir les signes du temps dans la vie des familles et, d’autre part, donner aux familles une raison de devenir sujet dans le cadre de la mission pastorale et de l’Eglise.
Il serait souhaitable, dans ce contexte, que le Synode trouve des approches nouvelles et proches de la vie pour une théologie du mariage et de la famille qui corresponde aux expériences actuelles des gens.
Les professionnels de la pastorale familiale et de la théologie reprochent aux lineamenta un manque de réflexion sur les découvertes en sciences humaines (sociologie, psychologie, sexologie..). Sans cette réflexion, le discours de l’Eglise sur le mariage et la famille court le danger du fidéisme ce qui grèverait fortement le témoignage de l’Eglise. Les professionnels font également remarquer que les contextes dans lesquels les différents couples, mariages et familles évoluent et se mesurent sont si différents dans le monde que la doctrine ecclésiale ne peut guère échapper à une contextualisation pour remplir ses tâches.
De nombreux fidèles exigent aussi de revoir et d’améliorer les conditions politiques, juridiques, sociales et économiques des familles. La pauvreté est citée en Suisse comme un facteur important de l’échec du mariage et de la famille. On demande aussi tout particulièrement à l’Eglise de trouver des itinéraires pastoraux pour la situation difficile des personnes sans permis de séjour ni statut légal (sans-papiers).
3. Au-delà de l’annonce et de la dénonciation, quelles sont les modalités choisies pour être présents comme Eglise auprès des familles dans les situations extrêmes ? (cf. n°8). Quelles stratégies éducatives employer pour les prévenir ? Que peut-on faire pour soutenir et renforcer les familles croyantes, fidèles au lien ?
La question montre bien la vision problématique décrite ci-dessus sur le mariage et la famille. Les situations extrêmes des familles sont vues uniquement sous l’angle de la fidélité au serment du mariage. Cela masque la multitude de situations problématiques existant pour et dans les familles, et pour lesquelles les fidèles attendent la solidarité de l’Eglise. Les fidèles réfutent aussi très clairement l’idée que ce sont surtout les crises de la foi qui provoquent des crises familiales. Ils rappellent plutôt à l’Eglise que les crises conjugales et familiales précèdent souvent les crises de la foi - dans une dimension inversement proportionnelle à l’assistance que l’Eglise apporte aux couples et aux familles en crise.
Pour les croyants (mais pas seulement pour eux), la fidélité est une valeur importante du mariage. La très grande majorité d’entre eux est attachée à l’idéal de l’indissolubilité du mariage. Mais les fidèles montrent aussi très clairement qu’ils connaissent le caractère provisoire et le défi constant que constitue une décision personnelle de fidélité : la capacité de prendre des décisions qui engagent toute une vie n’est pas automatiquement assortie de la capacité de les tenir. La foi chrétienne est certes ressentie comme un élément qui affermit leur décision d’être fidèles mais en même temps ils sont conscients des limites dans lesquelles ils la vivent. Les fidèles témoignent d’une haute sensibilité à ces limites et ils témoignent en parallèle de beaucoup de compréhension pour les situations qui empêchent les gens de tenir leur promesse de fidélité. Bien plus encore, nombre d’entre eux ne considèrent plus la fidélité au lien du mariage comme une valeur absolue, ils y voient même, selon les circonstances, le danger de vivre dans la fausseté, l’hypocrisie et de rester dans une situation de vie indigne. Rompre sa promesse de fidélité est souvent considéré comme le moindre mal. On constate chez les fidèles une forte disposition à peser soigneusement les circonstances personnelles des personnes concernées lorsqu’il s’agit de juger une révision de décision de vie.
D’après les fidèles et les professionnels de la pastorale des familles, l’Eglise pourrait être une aide en considérant le mariage comme un chemin nécessitant un suivi fiable. Un tel suivi serait le plus à même d’aider à redécouvrir et à approfondir sans cesse la décision de base de se marier. Du côté de la théologie, il est recommandé de préférer aux définitions juridiques du mariage des descriptions pleines de sagesse.
4. Comment l’action pastorale de l’Eglise réagit-elle à l’expansion du relativisme culturel dans la société sécularisée et au rejet qui en découle, de la part de beaucoup, du modèle de famille formé d’un homme et d’une femme unis par le lien conjugal et ouvert à la procréation ?
De nombreux fidèles ne partagent pas les présupposés de la question. Il manque aux lineamenta une réflexion différenciée sur les changements sociétaux dans les différents contextes du monde.
Du point de vue théologique, on suggère donc plutôt de montrer aussi bien la relativité contextuelle de la vision qu’a l’Eglise des familles que les relativités contextuelles de modèles alternatifs de familles.
Une conception chrétienne de la famille ne pourra redevenir significative en Suisse que lorsqu’on ne refusera plus en bloc de reconnaître et de respecter d’autres modèles familiaux et d’autres formes de partenariat.
L’importance de la vie affective (nos 9-10)
5. De quelles façons et avec quelles activités les familles chrétiennes sont-elles engagées à rendre témoignage de la progression de la maturation affective aux yeux des jeunes générations? (cf. nos 9-10) Comment pourrait-on aider la formation des ministres ordonnés sur tous ces thèmes ? Quelles figures d’agents pastoraux spécifiquement qualifiés apparaissent-elles les plus urgentes?
Agents pastoraux, prêtres et personnes mariées et en famille vivent en Suisse dans les mêmes conditions sociales et face aux mêmes enjeux culturels. Ceux-ci influencent l’organisation des mariages, des couples, des familles et du célibat. Il semble donc naturel que les différents cercles de personnes apprennent réciproquement et ensemble à vivre leurs vocations et rôles respectifs. C’est ainsi qu’on pourra éviter des déséquilibres dans les différentes formes de vie, comme celui de considérer à tort le mariage comme une symbiose ou la vie de célibataire comme une vie sans relations.
Le défi pour la pastorale (n°11)
6. Dans quelle proportion et à travers quels moyens la pastorale familiale ordinaire s’adresse-t-elle à ceux qui sont éloignés? (cf. n° 11). Quelles sont les lignes d’action mises en oeuvre pour susciter et mettre en valeur le « désir de famille » semé par le Créateur dans le coeur de toute personne et présente en particulier chez les jeunes, même chez ceux qui vivent des situations familiales qui ne correspondent pas à la vision chrétienne ? Quel retour effectif avons-nous de la mission accomplie auprès d’eux ? Parmi les non baptisés, la présence des mariages naturels est-elle consistante, par rapport également au désir, chez les jeunes, de fonder une famille?
La pastorale familiale se trouve devant de grands défis. La vision très juridique de la doctrine de l’Eglise sur le mariage rend tendanciellement plus difficile de montrer les dimensions du couple, du mariage et de la famille qui sont théologiques, spirituelles, personnelles et qui donnent sens à la vie. De nombreux efforts entrepris par la pastorale familiale et le témoignage de nombreux couples et familles cherchent à faire reconnaître une notion positive du mariage et de la famille mais se heurtent régulièrement à l’insistance démesurée accordée par l’Eglise à la dimension légale du mariage.
Questions sur la IIème Partie Le regard sur le Christ: l’Évangile de la famille
7. Le regard tourné vers le Christ ouvre de nouvelles possibilités. « En effet, chaque fois que nous revenons à la source de l’expérience chrétienne, de nouvelles routes et des possibilités impensables s’ouvrent » (n° 12). Comment est utilisé l’enseignement de l’Écriture Sainte dans l’action pastorale envers les familles ? Dans quelle mesure ce regard alimente une pastorale familiale courageuse et fidèle?
La perspective théologique relève fortement le regard tourné vers Jésus-Christ, vers les récits bibliques de la Sainte Famille et vers les nombreuses histoires des familles avec lesquelles Dieu a conclu une alliance dans l’histoire du salut. Un tel regard qui englobe aussi les connaissances actuelles en sciences bibliques, peut amener à un véritable approfondissement de la doctrine de l’Eglise sur le couple, le mariage et la famille.
Les fidèles en ont donné un témoignage dans l‘enquête en ayant lu les histoires de la Sainte Famille et d’autres couples et famille bibliques à leur manière dans lesquelles ils ont vu de nombreux liens avec les réalités familiales multiples de notre temps. Du point de vue des professionnels de la pastorale familiale, les récits bibliques se prêtent bien pour éveiller et fortifier la foi en la fidélité de Dieu vis-à-vis des hommes également dans des situations familiales difficiles.
8. Quelles valeurs du mariage et de la famille les jeunes et les conjoints voient se réaliser dans leur vie ? Et sous quelle forme ? Certaines valeurs peuvent-elles être mises en lumière ? (cf. n° 13). Quelles sont les dimensions de péché à éviter et à surmonter?
De nombreux fidèles indiquent que la famille est un lieu où les valeurs et la foi peuvent s’apprendre, se pratiquer et se vivre. Les valeurs mentionnées sont celles de l’amour, du respect des autres, de la solidarité, du partage, de la considération et de la gratitude.
9. En harmonie avec la pédagogie divine, quelle pédagogie humaine faut-il envisager pour mieux comprendre ce qui est requis de la pastorale de l’Église face à la maturation de la vie de couple, vers le futur mariage ? (cf. n°13).
La notion de pédagogie divine et le concept de son déploiement dans l’histoire du salut, tels qu’exprimés dans les lineamenta, sont un exemple du reproche souvent exprimé que le texte et la théologie des lineamenta sont très souvent éloignés de la réalité et peu utile pour vivre en couple et en famille. De nombreux fidèles se voient ici, quand ils abordent le texte de la doctrine de l’Eglise, confrontés à une pédagogie jugée autoritaire qu’ils ne pratiquent pas eux-mêmes ni ne cautionnent.
La société suisse actuelle a une conception d’une pédagogie fortement critique face à l’autorité. Les modèles éducatifs des familles modernes sont très différents de ce qu’ils étaient il y a seulement quelques dizaines d’années. Ce changement culturel se reflète aussi dans les attentes vis-à-vis de la perception qu’a l’Eglise de l’autorité, mais aussi dans la spiritualité et dans l’image de Dieu. Pour la plupart des catholiques, hommes et femmes, une pédagogie divine et ses contenus ne peuvent plus se transmettre comme des directives inconditionnelles de conduite de vie. C’est beaucoup plus l’expérience personnelle qui déterminera le bien-fondé des choix de vie et des décisions. Cela signifie pour l’Eglise la perte de son autorité et de son pouvoir sur les fidèles. Elle ne peut plus faire de Dieu et de ses lois une menace car la croyance en un Dieu vu comme un maître sévère est quasiment dépassée. En conséquence, toute tentative d’ingérence de l’Eglise dans les questions d’organisation de la vie, surtout si elle est assortie de la menace de sanctions, est considérée comme un dépassement de limites et une intrusion dans la sphère privée des gens ainsi qu’une violation ou une mise en question de leur autonomie.
L’Eglise ne peut transmettre ses contenus, son message, qu’en dialoguant, en tenant compte des expériences et en reconnaissant la liberté personnelle/ la liberté de conscience. Les fidèles attendent toujours de l’Eglise un soutien et un accompagnement, ils attendent aussi des réactions critiques mais ils ne lui ne lui accordent plus aucun paternalisme. Le discours qui fait de l’Eglise la maîtresse et des fidèles ses élèves, est souvent rejeté ; tout comme le discours qui fait de l’Eglise une mère lorsqu’il suscite l’impression d’une infantilisation des fidèles.
Il y a ici donc une dette portable : la notion de pédagogie n’est adaptée que si l’on peut rendre crédible que l’Eglise est capable d’une pédagogie/ pastorale qui se base sur les ressources des gens et pratique un authentique accompagnement de vie et non si elle pense secrètement connaître déjà le but d’une telle pastorale.
10. Que faire pour montrer la grandeur et la beauté du don de l’indissolubilité, de façon à susciter le désir de la vivre et de la construire toujours davantage ? (cf. n°14)
La plupart de fidèles sont attachés au principe de l’indissolubilité du mariage. Parallèlement parler d’indissolubilité est cependant plus souvent compris par les fidèles comme un problème que comme un don. Ils n’en perçoivent plus guère le noyau positif – mais, par contre, parfaitement bien l’aspect définitif qu’elle apporte à l’horizon du mariage. Il serait important ici de souligner le sens positif d’un engagement à cheminer durant toute sa vie avec quelqu’un en montrant le potentiel d’apprentissage et de croissance à vie qu’il recèle. Dans le contexte de la Suisse, cela devrait être lié à l’exigence posée par la société de construire sa propre biographie comme un projet. Une théologie du mariage doit tenir compte de ces conditions cadres pour formuler une définition positive – mais aussi réaliste- du mariage, qui montre clairement que le mariage est conçu comme un processus et une façon d’évoluer. Cette approche est liée à l’espoir de pouvoir donner ainsi des renseignements théologiquement corrects sur l’effet et la grâce du sacrement du mariage.
11. De quelle manière pourrait-on aider à comprendre que la relation avec Dieu permet de vaincre les fragilités qui sont inscrites aussi dans les relations conjugales ? (cf. n° 14). Comment témoigner que la bénédiction de Dieu accompagne tout mariage authentique ? Comment manifester que la grâce du sacrement soutient les époux tout au long du chemin de leur vie?
La plupart des fidèles ne se retrouvent guère eux-mêmes pas plus que leurs défis familiaux dans les paroles des lineamenta. Leur situation de vie reste sans lien avec les assertions sur la foi. Les propositions sur le mariage et la famille et l’idéal familial qu’elles induisent restent abstraites et sont ressenties comme idéalistes et coupées du réel. Il y a ici danger d’annoncer un enseignement de l’Eglise qui n’atteint plus les gens et leur histoire – et ceci dans un domaine de la vie qui est de la plus haute importance pour les gens.
Une des attentes fondamentales des fidèles envers l’Eglise et le Synode est la reconnaissance véritable de leurs expériences et de leurs réalités de vie. Ils ne parlent pas ici d’une « approbation » en bloc de leurs réalités mais attendent plutôt que l’Eglise ne formule pas sa doctrine et son annonce sans tenir compte des réalités de vie et des expériences.
Du point de vue de la théologie, il faudrait donc voir le caractère de partenariat du mariage et les défis que posent à un partenariat les parcours de vie de deux personnes, les admettre et porter un regard différencié du point de vue théologique. La vision simplificatrice et essentiellement pessimiste qui prédomine dans les lineamenta selon laquelle les évolutions culturelles mettent en danger le mariage ne satisfait pas cette exigence. La bénédiction de Dieu sur un mariage doit signifier, d’après les fidèles, plus que la protection contre les influences d’un monde vécu comme menaçant. Dans une société comme la Suisse où l’individualisation est une condition cadre incontournable, la conception du mariage doit, elle aussi, contenir des réponses positives à ces conditions cadres. Même à l’intérieur d’un mariage, les partenaires ne cessent pas d’être des individus ayant leur propre biographie. Il faut résoudre aussi sur le plan de la théologie du mariage la tension entre développement du couple et développement personnel. Les appels encore majoritaires aujourd’hui au renoncement, à l’altruisme, aux devoirs conjugaux, à l’observation des normes sexuelles, à être ouvert à la procréation et à se consacrer à l’éducation des enfants, etc…., ne satisfont plus aux attentes des fidèles sur une conception ecclésiale du mariage.
Dans la perspective théologique, il est proposé de souligner la persistance de la liberté des personnes même dans un mariage, liberté qui peut être protégée par la conscience positive que chaque partenaire est en lien avec Dieu et qui peut ainsi trouver sa place dans la dimension religieuse accordée à sa propre relation de couple. Une telle conception de la relation évite les malentendus d’une relation symbiotique à l’autre, de prétentions à le posséder et de l’idée que l’on doit être absolument transparent pour l’autre. Une telle conception éveille de plus un profond respect de l’autre personne qui est vue dans sa vocation personnelle et unique. Un tel respect permet aussi d’être prêt à supporter et à respecter l’altérité de l’autre. La pratique d’une telle attitude est un processus de longue haleine qui consiste à être attentif à sa vocation propre et à la vocation commune en tant que couple. Les deux échelons (la vocation individuelle et la vocation commune) devraient être conçus comme des histoires de croissance et remis constamment en lien. Le sacrement du mariage pourrait ainsi signifier que les conjoints sont l’un pour l’autre des signes du salut et, dans une formulation concrète, aussi des compagnons spirituels réciproques.
La famille dans le dessein salvifique de Dieu (nos 15-16)
12. Comment pourrait-on faire comprendre que le mariage chrétien correspond à la disposition originelle de Dieu et qu’il constitue donc une expérience de plénitude, et non pas une limite ? (cf. n° 13)
Les fidèles de Suisse sont, malgré leur adhésion de principe au mariage et à la promesse de l’indissolubilité du mariage, sensibles et retenus lorsque l’Eglise formule des attentes exagérées aux bénéfices d’un mariage. Ils rejettent tout idéalisme débordant. Un tel idéalisme est plus un facteur d’échec que de réussite d’un mariage, il empêche même souvent déjà de conclure un mariage.
13. Comment concevoir la famille comme « Église domestique » (cf. LG 11), sujet et objet de l’action évangélisatrice au service du Royaume de Dieu?
14. Comment promouvoir la conscience de l’engagement missionnaire de la famille ?
Epoux et familles veulent être reconnus comme sujets dans l’Eglise et également comme sujets de l’évangélisation. C’est seulement ainsi qu’ils peuvent, p.ex., trouver des formes d’expression religieuse qui leur correspondent. La condition indispensable pour que les familles puissent être Eglise domestique est que l’Eglise respecte les décisions que les personnes ont prises en leur âme et conscience sur la forme à donner à leur couple et famille. L’évangélisation des familles ne peut réussir que si sa subjectivité est pleinement mise en valeur, que si l’Eglise dialogue avec les familles, les reconnaît et les respecte et renonce à toute condamnation. Cette position de principe de l’Eglise doit se manifester aussi, dans le contexte de la Suisse, vis-à-vis des familles interconfessionnelles – p.ex. dans la question de la réception des sacrements.
La famille dans les documents de l‘Eglise (nos 17-20)
15. La famille chrétienne vit sous le regard aimant du Seigneur et c’est dans le rapport avec Lui qu’elle grandit comme véritable communauté de vie et d’amour. Comment développer la spiritualité de la famille et comment aider les familles à être un lieu de vie nouvelle dans le Christ ? (cf. n° 21)
16. Comment développer et promouvoir des initiatives de catéchèse qui fassent connaître et qui aident à vivre l’enseignement de l’Église sur la famille, en favorisant le dépassement de la distance éventuelle entre ce qui est vécu et ce qui est professé, et en proposant des chemins de conversion?
Si la pastorale de l’Eglise, comme l’entendent aussi les lineamenta, doit être plus qu’une simple application de la doctrine, le synode doit trouver des moyens pour reconnaître comme locus theologicus les réalités et expériences pastorales elles-mêmes, qui se déclinent différemment selon les divers contextes.
Cela signifie aussi qu’il faut souligner plus clairement la responsabilité pastorale des Eglises locales et renforcer en conséquence le rôle et la responsabilité des évêques locaux en matière de doctrine ainsi que l’authenticité de leur enseignement. Cela devrait aussi se refléter dans le droit canonique et dans une nouvelle pondération du droit canonique particulier. L’art de la différenciation, indispensable en ce qui concerne les situations et contextes très différents des réalités familiales, restreint nécessairement le rayon de validité du discours de l’Eglise universelle et exige donc une retenue intelligente de la part de l’Eglise universelle et du droit canonique. Il faut combler le fossé existant entre la vision du mariage reposant sur le droit canonique et celle qui repose sur la pastorale car il rend souvent difficile de développer une véritable spiritualité du mariage.
L’indissolubilité du mariage et la joie de vivre ensemble (nos 21-22)
17. Quelles sont les initiatives qui pourraient aider à comprendre la valeur du mariage indissoluble et fécond comme voie de pleine réalisation personnelle? (cf. n° 21)
Cf. réponse à la question 11.
18. Comment proposer la famille comme lieu unique, sous de nombreux aspects, pour réaliser la joie des êtres humains?
19. Le Concile Vatican II a exprimé son appréciation pour le mariage naturel, renouvelant ainsi une antique tradition ecclésiale. Dans quelle mesure les pastorales diocésaines savent aussi mettre en valeur cette sagesse des peuples, fondamentale pour la culture et la société communes ? (cf. n°22)
L’appréciation de la sagesse des peuples est saluée. Parallèlement, les résultats de l’enquête font état d’une incompréhension pour le fait que le Synode a une vision si négative sur la culture de la société occidentale et les formes de relations qu’on y trouve.
Couple, mariage et famille sont partout des réalités influencées par la culture et par les forces et faiblesse de ces cultures. La notion de «mariage naturel» ne devrait pas pousser à voir les formes de modernisation adoptées par les cultures occidentales uniquement comme un abandon d’une réalité naturelle idéalisée.
Le manque de compréhension que manifeste souvent l’Eglise face aux évolutions de la société occidentale a aussi favorisé une distance croissante et répandue en Suisse à l’égard de l’idée que se fait l’Eglise du mariage.
Vérité et beauté de la famille et miséricorde envers les familles blessées et fragiles (nos 23-28)
20. Comment aider à comprendre que personne n’est exclu de la miséricorde de Dieu et comment exprimer cette vérité dans l’action pastorale de l’Église envers les familles, en particulier celles qui sont blessées et fragiles ? (cf. n° 28)
Les fidèles de Suisse témoignent dans leurs réponses d’une très grande confiance dans la miséricorde divine. Ils se plaignent souvent que leur foi et leur confiance en la miséricorde de Dieu ne soient souvent entamées par la pratique officielle de l’Eglise qui exclue durablement des personnes de l’accès aux sacrements et d’une pleine participation à la communauté de l’Eglise.
Les fidèles saluent donc la pratique largement plus ouverte dans les paroisses et en pastorale, qui donne un témoignage plus vrai de foi que ne le prévoit le droit canonique. De nombreux fidèles soulignent notamment que leur foi ne leur permet pas d’imaginer que la fidélité de Dieu reste refusée précisément à des gens en situation d’échecs. Dans la perspective théologique, il faut trouver comment faire comprendre la contradiction entre «loi divine» et miséricorde divine dont personne n’est exclu.
21 Comment les fidèles peuvent-ils montrer à l’égard des personnes qui ne sont pas encore parvenues à la pleine compréhension du don d’amour du Christ, une attitude d’accueil et d’accompagnement confiant, sans jamais renoncer à l’annonce des exigences de l’Évangile ? (cf. n° 24)
L’attente que l’on arrive à une pleine compréhension du don d’amour du Christ est une de ces exigences idéalistes trop élevées contre lesquelles de nombreux fidèles s’élèvent. Une telle perspective a pour seul résultat de ne voir que les déficits de toute réalité. Qui voudrait avoir la prétention d’avoir jamais parfaitement compris le don d’amour du Christ et qui pourrait le vérifier et en tirer éventuellement des jugements et des sanctions ?
Il faut voir aussi le renoncement répandu des fidèles de Suisse au sacrement du mariage comme une réplique aux exigences extrêmes qui y sont liées. Pourtant les fidèles adhèrent à ses idéaux notamment à l’idéal de l’indissolubilité du mariage. Mais ils connaissent aussi les limites réalistes de cet idéal dans la réalité de la vie des gens. Les fidèles témoignent d’une forte conception du mariage comme processus, comme processus permanent de croissance et de changement. Mais ils considèrent comme improductif d’exiger d’atteindre un idéal inatteignable, trop grand pour eux, et que l’Eglise sanctionne si on ne l’atteint pas et ils le rejettent en conséquence. De nombreux fidèles ne voient pas non plus pourquoi seul le mariage religieux est soumis à des attentes aussi élevées et à des sanctions radicales de la part de l’Eglise.
En ce qui concerne la croissance et la maturation des relations et des couples, les fidèles se déclarent grandement d’accord avec des étapes sur le chemin du mariage. Les relations prénuptiales ne sont pas seulement tolérées, elles paraissent la voie normale dans la vision d’une préparation correcte à la promesse durable du mariage.
Les positions des fidèles montrent aussi la nécessité non seulement de réfléchir à une relativisation dans l’atteinte de l’idéal du mariage mais également de poser la question de la relativisation de l’idéal lui-même. De nombreux fidèles se montrent bien informés sur les dynamiques sociales qui remodèlent toujours aussi les idéaux de la vie et de la cohabitation, un phénomène qui se manifeste déjà notamment dans les témoignages bibliques. Les fidèles ont ainsi régulièrement des problèmes à comprendre la doctrine ecclésiale qui donne l’impression de pouvoir définir encore des idéaux et des normes immuables. Les formes d’argumentation basées sur le droit naturel sont clairement critiquées dans ce contexte. Il faudrait donc charger le Synode de réfléchir à des moyens d’atteindre l’idéal mais aussi de redéfinir l’idéal lui-même et de le comprendre en fonction des situations de vie des gens d’aujourd’hui. C’est la seule manière d’éviter véritablement le reproche d’une hypocrisie persistante de l’Eglise (d’un clivage entre idéal et pastorale).
22. Qu’est-il possible de faire pour que dans les diverses formes d’union – où l’on peut trouver des valeurs humaines – l’homme et la femme ressentent le respect, la confiance et l’encouragement à grandir dans le bien de la part de l’Église et soient aidées à atteindre la plénitude du mariage chrétien ? (cf. n° 25)
Ce passage est perçu comme condescendant. Il éveille l’impression que l’Eglise ne valorise pas entièrement la profondeur des relations de couples hors d’un mariage chrétien. Une telle reconnaissance serait cependant une condition indispensable au dialogue avec les personnes qui vivent ces formes de partenariats ou de couples.
Questions sur la IIIème partie : la discussion : perspectives pastorales
Annoncer l’Evangile de la famille aujourd’hui, dans les différents contextes (nos 29-38)
23. Dans la formation des prêtres et des autres agents pastoraux, comment la dimension familiale est-elle cultivée ? Les familles sont-elles directement impliquées dans cette formation ?
24. Est-on conscient que l’évolution rapide de notre société exige une attention constante au langage dans la communication pastorale ? Comment témoigner efficacement de la priorité de la grâce, de sorte que la vie familiale soit projetée et vécue comme accueil de l’Esprit Saint?
25. Dans l’annonce de l’Évangile de la famille, comment peut-on créer les conditions permettant à chaque famille d’être telle que Dieu la veut et d’être socialement reconnue dans sa dignité et dans sa mission? Quelle « conversion pastorale » et quels approfondissements ultérieurs doivent être mis en oeuvre dans cette direction?
Les réactions des fidèles montrent clairement que la reconnaissance par l’Eglise des différentes formes de familles est la condition pour que les familles puissent se développer selon leur vocation propre. Des normes et des directives d’organisation imposées de l’extérieur comme expression de la famille telle que Dieu la veut ne rencontrent plus guère d’acceptation. L’action de l’Eglise en pastorale familiale ne peut exister que dans le respect de la diversité des itinéraires familiaux et des décisions que les personnes concernées prennent en leur âme et conscience. C’est seulement sur cette base que l’Eglise pourra être considérée comme une interlocutrice et génératrice d’impulsions dans la formation de la conscience des gens et le développement de leurs familles.
26. La collaboration, au service de la famille, avec les institutions sociales et politiques est-elle considérée dans toute son importance ? Comment est-elle concrètement mise en oeuvre ? De quels critères s’inspire-t-on pour cela? Quel rôle peuvent jouer en ce sens les associations familiales? Comment cette collaboration peut-elle être également soutenue par une franche dénonciation des processus culturels, économiques et politiques qui minent la réalité familiale?
27. Comment favoriser une relation entre famille, société et politique au profit de la famille ? Comment encourager le soutien de la famille par la communauté internationale et les États?
Guider les futurs époux sur le chemin de la préparation au mariage (nos 39-40)
28. Comment les itinéraires de préparation au mariage sont-ils proposés de façon à mettre en évidence la vocation et la mission de la famille selon la foi au Christ ? Sont-ils effectués comme proposition d’une expérience ecclésiale authentique ? Comment les rénover et les améliorer?
29. Comment la catéchèse d’initiation chrétienne présente-t-elle l’ouverture à la vocation et à la mission de la famille ? Quelles avancées en ce domaine sont considérées comme plus urgentes ? Comment proposer le rapport entre le baptême, l’eucharistie et le mariage ? De quelle façon peut-on mettre en évidence le caractère de catéchuménat et de mystagogie que revêtent souvent les itinéraires de préparation au mariage ? Comment faire participer la communauté à cette préparation?
Une pastorale du mariage et de préparation au mariage basée sur la mystagogie rencontre un fort assentiment. Cette approche correspond bien à la manière dont de nombreuses personnes abordent les questions du mariage et de famille parce qu’elle part des expériences et non de vérités « objectives » sur le mariage.
On souhaite en principe une détermination précise des besoins des personnes qui viennent à la préparation au mariage. Il pourrait être judicieux de proposer une bénédiction plutôt que le sacrement du mariage si cela correspond aux attentes effectives des époux. L’Eglise devrait adopter par principe une attitude de bienvenue envers toute personne désireuse de témoigner à l’Eglise de son couple, resp. sur le plan religieux.
Fidèles et professionnels recommandent d’adapter la préparation au mariage aux changements des conditions sociales et notamment de prendre en considération le fait que le mariage religieux est devenu aujourd’hui une décision de minorité et ne va plus du tout de soi depuis longtemps. Il faut pour cela accorder plus de poids à la dimension religieuse du mariage comme une vocation et aussi percevoir la chance de rapprocher plus profondément de leur foi et de l’Eglise des personnes qui s’intéressent à conclure un mariage religieux. Finalement une forme renouvelée de préparation au mariage devrait aussi inclure la possibilité pour un couple de mettre à profit une phase plus longue pour approfondir sa prise de décision.
Accompagner les premières années de la vie conjugale (n° 40)
30. Tant dans la préparation que dans l’accompagnement des premières années de vie conjugale, l’importante contribution du témoignage et du soutien que peuvent apporter les familles, les associations et les mouvements familiaux est-elle assez mise en relief ? Quelles expériences positives peut-on mentionner en ce domaine?
31. La pastorale de l’accompagnement des couples durant les premières années de vie familiale – a-t-on fait observer pendant le débat synodal – a besoin d’un nouveau développement. Quelles initiatives plus significatives ont-elles déjà été réalisées ? Quels aspects faut-il renforcer au niveau paroissial, au niveau diocésain ou dans le cadre des associations et des mouvements?
La réalité des couples en Suisse montre que ceux-ci vivent souvent déjà depuis des années ensemble et ont souvent déjà des enfants avant de se décider à se marier à l’Eglise. Il est donc problématique de parler de « jeunes couples » quand on parle du temps qui suit le mariage car ces couples ont souvent une grande expérience de la vie en commun et de la gestion de leur relation.
Il n’est pas rare que des jeunes couples aient déjà fait l’expérience de la séparation et de la rupture d’une relation lors de relations précédentes. La crédibilité de l’Eglise augmentera vis-à-vis des gens si elle réussit à assister avec bienveillance et sans condamnation les personnes dont les couples échouent ou se heurtent à des problèmes et à des conflits. Cela implique aussi de changer d’attitude et de discours sur la question de la sexualité qui, en Suisse, n’existe plus depuis longtemps uniquement dans le cadre du mariage. Il faudrait développer ces aspects notamment dans la pastorale des adolescents et des jeunes adultes.
La pastorale du couple et du mariage doit débuter très tôt en Suisse et accompagner les adolescents et les jeunes déjà dans leurs tentatives de fonder et de vivre des relations. La condition pour rendre cet accompagnement possible est, ici aussi, – comme pour les couples, le mariage et la famille en général –, de reconnaître l’autonomie fondamentale et la liberté des jeunes gens et d’avoir une attitude positive face à leurs espoirs et à leurs idéaux. C’est seulement sur cette base que l’Eglise aura la possibilité et la permission de s’adresser aux jeunes couples avec des impulsions de l’Evangile.
Afin d’entretenir le sacrement du mariage comme itinéraire et communauté de parcours, on pourra, dans la période qui suit le mariage à l’Eglise, multiplier aussi les aspects religieux et spirituels dans l’accompagnement des jeunes couples afin de favoriser le développement du caractère religieux de la communauté conjugale. On recommande ici tout spécialement l’aide de communautés spirituelles, les cercles de jeunes parents et l’accompagnement par des couples expérimentés. Cette approche pourrait aussi permettre d’attacher plus étroitement les couples à la communauté de l’Eglise.
La pastorale des personnes qui vivent en union civile ou en concubinage (nos 41-43)
32. Quels critères faut-il considérer en vue d’un discernement pastoral correct des diverses situations, à la lumière des enseignements de l’Église, pour qui les éléments constitutifs du mariage sont l’unité, l’indissolubilité et l’ouverture à la procréation?
La diversité des situations et des conditions culturelles et sociétales exige d‘être constamment prêt au discernement. Le travail de discernement qui influence la pastorale, l’évolution des enseignements et du droit canonique doit être effectué en contexte. Il est donc absolument indispensable de renforcer une véritable responsabilité de l’Eglise locale en pastorale, en doctrine et en droit.
33. La communauté chrétienne est-elle en mesure d’être pastoralement impliquée dans ces situations ? Comment aide-t-elle à discerner les éléments positifs de ceux négatifs de la vie de personnes unies par des mariages civils, de façon à les orienter et à les soutenir au long du chemin de croissance et de conversion vers le sacrement du mariage ? Comment aider ceux qui vivent en concubinage à opter pour le mariage?
Les fidèles montrent, dans leurs nombreuses réactions, qu’ils sont volontiers prêts à prendre des responsabilités pour l’organisation de la pastorale familiale et de donner, dans ce cadre, des impulsions pour que la conception théologique du couple, du mariage et de la famille continue à évoluer. Les fidèles sont les experts en ce qui concerne les conditions dans lesquelles la famille est vécue. Ils témoignent de compréhension pour les nombreux itinéraires et détours aboutissant à la réussite d’un couple, d’un mariage d’une famille. Mais ils peuvent aussi – au vu de leurs propres expériences – être un encouragement, une consolation, un affermissement et un soutien pour d’autres.
L’accompagnement de couples par d’autres couples est considéré comme un bon moyen pour la pastorale. Il faut pour cela une plus grande confiance dans l’attitude spirituelle, pastorale et ecclésiale des fidèles et la volonté d’encourager leurs manières d’accompagner les couples.
34. En particulier, quelles réponses donner aux problématiques soulevées par l’enracinement des formes traditionnelles de mariages par étapes ou arrangé par les familles?
La conception du droit canonique actuel sur le mariage implique aussi une gradation du mariage (du matrimonium ratum au matrimonium consummatum). Cette gradation dépend de la culture et pourrait aussi être saisie autrement, d’autant plus qu’elle entre de toute façon en tension avec la conception du mariage de Gaudium et spes. Il faudrait analyser avec prudence des formes culturelles de gradation et, le cas échéant, les reconnaître comme des moyens judicieux pour se tester soi-même.
Prendre soin des familles blessées (séparés, divorcés non remariés, divorcés remariés, familles monoparentales) (nos 44-54)
35. La communauté chrétienne est-elle prête à prendre soin des familles blessées pour leur faire vivre l’expérience de la miséricorde du Père ? Comment s’engager pour éliminer les facteurs sociaux et économiques qui souvent les déterminent ? Qu’a-t-il été fait et que faut-il encore faire pour accroître cette action et la conscience missionnaire qui la soutient?
36. Comment encourager la définition de lignes pastorales communes au niveau de l’Église particulière? Comment développer à cet égard le dialogue entre les diverses Églises particulières «cum Petro e sub Petro»?
De nombreux fidèles estiment qu’il serait utile de moderniser le droit canonique en y prenant mieux en compte les expériences pastorales et les réalités de vie des gens. Du côté du droit canonique, on propose de compléter le discours sur l’indissolubilité d’un mariage par la vision pastorale d’un mariage dont on pourrait la destruction irréversible (la mort). On ne mettrait ainsi pas au premier plan la dissolution d’un mariage par un acte juridique mais le constat de la rupture définitive de la relation conjugale. Sur cette base, il devrait être possible à l’Eglise de reconnaître une nouvelle relation et de lui donner de la valeur.
De nombreuses remarques des fidèles vont dans cette direction. Elles dénotent une sensibilité pleine de nuances à la diversité des causes de l’échec ou de la mort d’une relation conjugale, de sa fin progressive, sa rupture définitive. En même temps, ils connaissent la problématique d’une déclaration canonique en nullité qui «nie» simplement les expériences positives d’un mariage qui a été annulé par la suite, ce qui n’est pas juste envers le vécu des personnes concernées.
37. Comment rendre plus accessibles et souples, si possible gratuites, les procédures de reconnaissance des cas de nullité ? (n° 48).
La facilitation des procédures de reconnaissance de la nullité d’un mariage trouve une approbation de principe. Des questions financières ne devraient pas empêcher une clarification canonique. Le raccourcissement des procédures et une gratuité générale sont jugés positifs. Parallèlement, un profond scepticisme se fait jour envers le constat en nullité en lui-même. Celui-ci ne peut être recommandé sans autre comme étant la solution en pastorale pour résoudre la situation des divorcés. Trop de questions restent irrésolues également sur le plan théologique dans une approche juridique de l’échec ou de la mort d’un mariage. Il en va de même pour les implications psychologiques d’une telle procédure. Très souvent, les personnes rejettent de toute façon une telle voie pour elles-mêmes par honnêteté et respect envers les décisions qu’elles ont prises un jour et envers une partie de leur histoire de vie, surtout lorsque des enfants sont nés de leur première union.
Il y a souvent, dans les procès en nullité, des difficultés pour faire constater la non-validité d’un mariage. Il en résulte des injustices si un mariage est invalide mais qu’on ne peut pas le prouver. Il faudrait accorder ici plus de place au jugement de conscience des personnes.
38. La pastorale sacramentelle à l’égard des divorcés remariés a besoin d’un approfondissement ultérieur, en évaluant la pratique orthodoxe et en tenant compte de « la distinction entre situation objective de péché et circonstances atténuantes » (n° 52). Quelles sont les perspectives au sein desquelles se situer ? Quelles avancées sont possibles ? Quelles suggestions pour remédier à des formes d’empêchement non dues ou non nécessaires?
Le voeu le plus pressant des fidèles de Suisse vis-à-vis de la pastorale concrète est que les divorcés remariés cessent d’être exclus des sacrements. Les fidèles ressentent cette norme officielle comme un scandale et la rejettent. Ils saluent unanimement la pratique largement répandue dans les paroisses. En même temps, cette entorse à la doctrine officielle, ancrée depuis longtemps dans les structures, est un problème persistant. On est scandalisé que la doctrine officielle ne soit en mesure ni d’entrer en matière sur des conclusions tirées du vécu des gens ni de faire ainsi face aux inconsistances de la théologie du mariage et de la famille.
Les fidèles montrent très clairement que la conception des divorces devrait être approfondie et qu’il faudrait absolument la nuancer. Cela fait une différence qu’un mariage soit dénoncé unilatéralement, qu’il se soit effiloché, transformé en échec ou soit mort de fait au cours des années ou qu’aucun retour au premier mariage ne soit possible à cause de nouvelles relations de couples ou de nouvelles familles. La distinction établie par Mgr Jean-Paul Vesco entre «infraction instantanée» et «infraction continue» trouve un assentiment dans de nombreuses prises de positions de la théologie et de la pastorale.
Il s’agit, dans ce sens, de saluer la déclaration selon laquelle les Pères synodaux ressentent « l’urgence d’itinéraires pastoraux nouveaux ». Mais c’est également le moment de discuter les questions théologiques que pose la doctrine en vigueur. Il y a des questionnements exégétiques, historiques et systématiques à la conception actuelle de l’Eglise officielle sur l’indissolubilité du mariage et à la pratique prescrite par l’Eglise de l’exclusion sans distinction des sacrements en cas de remariage civil.
Les fidèles trouvent souvent la notion de «communion spirituelle» incompréhensible et contradictoire en elle-même. Cette proposition, qui recèle aussi le danger de montrer publiquement à chaque célébration eucharistique qui n’est pas admis aux sacrements et de discriminer ainsi les personnes concernées, suscite un rejet unanime. Elle n’est pas applicable en Suisse et recèle le danger d’éloigner totalement les personnes concernées de la célébration de l’Eucharistie, sauf si l’une d’entre elles pense que c’est la bonne voie pour elle-même et agisse en conséquence.
Les formes évoquées à diverses reprises de pénitence, d’attente, d’éclaircissement avant que les divorcés ne soient de nouveau admis aux sacrements suscitent des appréciations diverses. Une partie des fidèles a tendance à laisser cette décision aux personnes concernées elles-mêmes et laisse ouverte l’option de définir des critères permettant de prendre cette décision, p.ex. pour clarifier la question des responsabilités découlant d’un premier mariage et d’une première famille. Une autre partie des fidèles peut même imaginer la régularisation d’une procédure de réadmission aux sacrements. Ici aussi il faut absolument renoncer à toute mise à ban public. On pourrait parler ici au lieu d’un itinéraire de pénitence d’un itinéraire de guérison.
39. Les normes en vigueur actuellement permettent-elles d’apporter des réponses valables aux défis posés par les mariages mixtes et par les mariages interconfessionnels ? Faut-il tenir compte d’autres éléments?
De nombreux fidèles de Suisse vivent en situation de couples et de familles mixtes. La question de l’admission à l’Eucharistie se pose souvent. Dans ce cas aussi, comme pour de nombreuses autres questions sur le mariage et la famille, les fidèles décident eux-mêmes de leur pratique et le font selon leur foi et leur conscience. Toute directive de l’Eglise est souvent perçue comme une mise sous tutelle et a vite pour résultat que des familles entières, également celles et ceux parmi elles qui sont catholiques, ne coupent toute relation avec l’Eglise.
Renforcer la conception de «l’Eglise domestique » constituée par des baptisés pourrait valoriser sur le plan ecclésiologique les couples et les familles mixtes et reconnaître qu’elles sont représentations de l’alliance de Dieu avec les hommes. Sur cette base, on pourrait jeter un regard plus bienveillant sur la pratique de l’hospitalité eucharistique.
L’attention pastorale envers les personnes ayant une tendance homosexuelle (nos 55-56)
40. Comment la communauté chrétienne accorde-t-elle son attention pastorale aux familles dont certaines personnes en leur sein ont une tendance homosexuelle ? En évitant toute discrimination injuste, de quelle façon est-il possible de s’occuper des personnes dans ces situations à la lumière de l’Évangile ? Comment leur proposer les exigences de la volonté de Dieu sur leur situation?
Les fidèles se montrent en grande majorité irrités par les déclarations des lineamenta sur les personnes homosexuelles. Il est souvent dit que le texte ne prend pas au sérieux les personnes homosexuelles et les dévalorise. La plupart des fidèles estiment que le souhait qu’ont des personnes homosexuelles de vivre des relations et des couples est justifié et ils ne voient pas pourquoi ce désir ne pourrait pas être vécu dans un couple. L’exigence posée aux personnes homosexuelles de vivre dans l’abstinence est rejetée comme étant injuste et inhumaine.
On juge insuffisant de parler de «personnes ayant une orientation homosexuelle» étant donné les nouvelles connaissances en sciences humaines. Les déclarations en contradiction avec les découvertes scientifiques éveillent l’impression de devoir justifier une condamnation morale injustifiée des actes homosexuels. La crédibilité de l’Eglise est ici en jeu.
La plupart des fidèles jugent inacceptable que les personnes homosexuelles soient considérées uniquement comme objets de la pastorale et qu’on leur conteste ainsi la dignité d’être sujets de l’Eglise. Les personnes homosexuelles ne devraient pas être vues comme des personnes malades ou ayant particulièrement besoin d’aide. On souhaite que l’Eglise traite les homosexuels avec respect et apprécie leur participation dans l’Eglise.
Le discours sur l’impossibilité de toute analogie entre le mariage et l’union homosexuelle se heurte à une forte incompréhension. Même si une partie des fidèles se montre sceptique envers une pleine égalité entre les unions homosexuelles et le mariage, la grande majorité souhaite que l’Eglise les reconnaisse, les estime et aussi les bénisse parce que ces relations permettraient de vivre des valeurs importantes qui autorisent absolument aussi, du point de vue des fidèles, des analogies avec le mariage.
Du point de vue théologique, de nombreuses questions se posent, p.ex. la question de l’examen des raisons bibliques de rejeter les relations homosexuelles, la question de la reconnaissance de valeurs dans les unions homosexuelles, la question de l’importance anthropologique de la sexualité dans la vie de tout être humain et la question des conséquences que cette annonce de l’Eglise a pour les personnes homosexuelles lorsqu’elle leur rend l’acceptation d’elles-mêmes plus difficile.
La transmission de la vie et le défi de la dénatalité (nos 57-59)
41. Quelles sont les initiatives les plus significatives qui ont été prises pour annoncer et promouvoir efficacement l’ouverture à la vie, ainsi que la beauté et la dignité humaines de devenir mère ou père, à la lumière par exemple de l’Encyclique Humanae Vitae du Bienheureux Paul VI ? Comment promouvoir le dialogue avec les sciences et les technologies biomédicales de façon à ce que soit respectée l’écologie humaine de l’engendrement?
42. Une maternité/paternité généreuse a besoin de structures et d’instruments. La communauté chrétienne vit-elle une solidarité et une subsidiarité effective ? Comment ? Propose-t-elle aussi courageusement des solutions valides au niveau sociopolitique ? Comment encourager l’adoption et la garde des enfants comme signe très élevé d’une générosité féconde ? Comment faire en sorte que les enfants soient élevés avec attention et respect?
43. Le chrétien vit la maternité/paternité comme réponse à une vocation. Dans la catéchèse, cette vocation est-elle suffisamment soulignée ? Quels parcours de formation sont proposés pour qu’elle guide effectivement les consciences des époux ? A-t-on conscience des graves conséquences des changements démographiques?
La conception des enfants change dans la société et dans la vie des familles. Les enfants sont souvent vus comme « projet » pour une famille. Des aspects liés à la possibilité de planifier la fondation et la vie de famille prennent donc plus de poids. Il est important cependant de ne pas oublier que les enfants sont un cadeau de Dieu. Cette dimension pourrait aussi devenir un contrepoids au trop grand désir de planification de la famille.
L’histoire de la réception de Humanae Vitae a laissé de profondes traces dans l‘Eglise et chez les fidèles. On peut parler d’une rupture de confiance entre les fidèles et l’Eglise, rupture qui n’a pas encore été surmontée. Dans ce contexte, tout rappel de cette encyclique semble remuer le couteau dans la plaie. De nombreuses réponses laissent entendre que l’Eglise ferait mieux de s’exprimer avec plus de retenue sur les questions de la sexualité et de s’abstenir de normes et de restrictions concrètes.
L’intention exprimée dans les lineamenta est cependant accueillie positivement dans l’ensemble. Prendre comme critère déterminant la dignité de l’être humain et non le choix des moyens pourrait aussi permettre de redonner du poids à la voix de l’Eglise face aux nombreux nouveaux enjeux dans le domaine de la reproduction médicale.
On considère, dans ce contexte, que c’est une grave lacune que les lineamenta n’évoquent la conscience qu’à la question 43 et encore seulement avec méfiance puisqu’on demande immédiatement si la conscience a été correctement formée. Sinon, il n’y a aucune reconnaissance de la conscience, ce qui est considéré comme un gravissime déficit du texte et de sa vision des choses.
44. Comment l’Église combat-elle la plaie de l’avortement en favorisant une culture de la vie qui soit efficace?
Les fidèles s’efforcent à une culture de la vie dans leurs couples, unions et familles et ils y mettent beaucoup du leur. Parallèlement, ils reconnaissent les situations extrêmement difficiles des gens qui doivent prendre des décisions sur la vie. Ils sont ainsi très prêts à aider des gens à choisir la vie. En même temps, de nombreux fidèles rejettent toute forme d’engagement pour une culture de la vie qui accule, condamne ou stigmatise des gens qui se trouvent de toute façon déjà en grandes difficultés.
Le défi de l’éducation et le rôle de la famille dans l‘évangélisation (nos 60-61)
45. Accomplir leur mission éducatrice n’est pas toujours aisé pour les parents : trouvent-ils solidarité et soutien dans la communauté chrétienne ? Quels parcours de formation peut-on suggérer ? Qu’est-ce qui peut être fait pour que la tâche éducative des parents soit reconnue aussi au niveau sociopolitique ?
46. Comment stimuler chez les parents et dans la famille chrétienne la conscience du devoir de transmission de la foi comme dimension intrinsèque à l’identité chrétienne ?
L’idée que la crise de la foi est la cause des crises familiales est unanimement rejetée. Les fidèles et les professionnels de la pastorale familiale contestent qu’une foi solide puisse préserver les familles des influences de la culture et de la société. Une telle vision dualiste des choses ne correspond pas à l’expérience des fidèles.
On fait plutôt l’expérience en pastorale que les crises familiales provoquent des crises de la foi. L’Eglise doit se demander ici si, dans sa gestion des crises et des échecs des mariages ou des familles, elle contribue vraiment à expérimenter la foi comme fortifiant et comme encouragement. Elle devrait aussi constater que c’est souvent une crise de l’Eglise et de sa manière d’agir qui provoque des crises de la foi et n’aide pas en cas de crises familiales.
On considère qu’il est du devoir inaliénable de l’Eglise et de la pastorale familiale de soutenir les parents, pères et mères, dans l’éducation (religieuse) des enfants. Les familles ne devraient cependant pas porter seules la tâche de transmettre la foi. L’enseignement religieux à l’école et la catéchèse dans la paroisse ainsi que des propositions de la pastorale des enfants et de la jeunesse, notamment celles des organisations de jeunesse, sont considérées comme des compléments indispensables pour garantir la transmission de la foi.
De plus, on préconise un plus grand engagement politique en faveur de la famille. Il faudrait, dans ce contexte, accorder une attention particulière aux questions des facteurs de pauvreté et à la situation des familles monoparentales.
Pour consulter ou élécharger l'intégralité de ce document de 20 pages, cliquez ICI